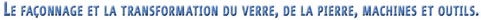La restauration des monuments historiques
Comprendre le passé
La restauration d’un monument historique naît toujours de l’admiration devant un travail de création et de construction effectué voilà parfois bien des siècles. Car un ouvrage ne traverse le temps que si au-delà de sa fonction utile de bâtiment d’habitation, de défense, de culte,... une magie faite d’art et de technique a dépassé sa destination initiale.
Le premier travail des techniciens des monuments historiques est de "saisir" la magie des lieux dans toutes ses dimensions. Appréhension de l’espace, de l’intégration au site, des conditions d’édification initiale, histoires d’un bâtiment qui a parfois subi autant des assauts des hommes que du temps.
Cette étape passe par une recherche historique, iconographique, photographique... auprès des bibliothèques locales, des centres d’archives, des musées, des universités...
De cette compréhension du passé dépend toute la qualité de la restauration, rendre au bâtiment son aspect mais aussi son esprit initial.
Travail d’art et de passion, la rénovation d’un monument historique est également un acte économique. Le respect du passé n’implique pas l’archaïsme technologique ; au contraire les techniques les plus modernes et les plus sophistiquées sont utilisées pour mener à bien le chantier.
Ainsi le D.A.O. qui permettra d’optimiser la stéréodomie et le travail de l’appareilleur ; ou bien encore les techniques d’injection de résine qui consolident les structures sans les désorganiser.
L’objectif à ce niveau est de mettre au service d’un état d’esprit, les techniques modernes qui assureront une fiabilité maximale de l’intervention ainsi qu’une maîtrise des coûts.
Perpétuer les traditions
L’ambiance autant que l’allure du monument rénové dépendent d’une multitude de détails qui vont du choix des matériaux à leur traitement et à leur assemblage.
Pour rendre aux édifices leur éclat et leur aspect initiaux, les techniciens respectent les anciennes techniques de construction.
Formés aux métiers d’antan, les compagnons exécutent les chantiers en utilisant les matériaux classiques et traditionnels comme la chaux, la pierre ou la brique, si possible d’époque.
Signes particuliers des monuments, les ornementations sont souvent les parties qui ont subi le plus durement l’action de l’érosion naturelle ou celles plus pernicieuses de la pollution et des hommes.
Le tailleur de pierre doit alors refaire les gestes qui, des siècles auparavant, avaient donné vie aux mêmes motifs, fleurons, rosaces, moulures...
Africaver, un investissement dans le verre automobile.
Créée à la faveur de la filialisation de l’Enava en 1997, la société Africaver pense à la mise en place d’une unité de production à l’ouest du pays pour se rapprocher du futur pôle automobile.
Implantée dans la zone industrielle d’Ouled Salah (Taher, wilaya de Jijel), l’entreprise publique économique Spa Africaver songe sérieusement à s’installer, en joint-venture avec une entreprise française, dans l’Oranie pour profiter de la mise en place du pôle automobile dans la région et offrir du verre automobile aux différentes usines qui y éliront domicile.
Un choix qui s’explique également par l’envie des deux partenaires de se rapprocher des zones franches d’Oujda mais aussi de l’Espagne et ses usines, pour profiter d’un coût de transfert moins onéreux que celui de l’est du pays, l’exportation étant un objectif plus que nécessaire, selon le représentant de l’entreprise française, rencontré lors du séminaire sur la sous-traitance .
Coralie Quincey - Sculpteur
4 Le Peyrat 33410 Sainte Croix du Mont
Tél. : 05 56 76 77 16![]() 05 56 76 77 16 / 06 83 75 61 61
05 56 76 77 16 / 06 83 75 61 61![]() 06 83 75 61 61 coraliequincey.blog4ever.com
06 83 75 61 61 coraliequincey.blog4ever.com
"Sculpteur et tailleur de pierre depuis bientôt 20 ans, j'ai appris le métier pendant 10 ans avec des artisans tailleurs de pierre en Gironde : restauration de façades, cheminées de style, agencement d'intérieurs en pierre, création de fontaines, etc... Après avoir découvert le marbre des Pyrénées, je me suis tournée vers la sculpture de création. Aujourd'hui, je travaille le marbre et la pierre dans mon atelier à Sainte Croix du Mont."
STÉRÉOTOMIE
Au sens premier du terme, la stéréotomie est l'art de découper différents volumes en vue de leur assemblage ; en architecture, elle désigne plus spécifiquement l'art de la coupe des pierres en vue de la construction des voûtes, trompes, coupoles ou volées d'escaliers... Si l'on parle encore de la « stéréotomie du bois » à propos de l'assemblage des bois de charpente, on constate que ce sens disparaît dans différents dictionnaires d'architecture, que ce soit celui de D'Aviler, qui fait autorité au XVIIIe siècle, ou du Vocabulaire de l'architecture publié par le ministère des Affaires culturelles en 1972. Ce glissement de sens n'est pas fortuit. Contrairement au charpentier qui réalise le squelette d'un volume, au chaudronnier qui en détermine la peau, le tailleur de pierre travaille directement la masse du matériau auquel n'importe quelle forme peut être donnée. Grâce à l'assemblage judicieux de pierres de petites dimensions taillées en forme de coin, les claveaux ou voussoirs, qui ne tiennent entre eux que par la pression que chacun exerce sur ses voisins, le tailleur réalise des éléments architecturaux de grande portée. Mais à la différence de l'appareillage des murs, la stéréotomie suppose la réalisation de surfaces non planes (ou de surfaces planes horizontales) et l'interpénétration fréquente de telles surfaces, ce qui pose à l'appareilleur de délicats problèmes pour déterminer chaque voussoir. Dans l'Antiquité, la stéréotomie évite d'ailleurs systématiquement ce type de pénétration et ne connaît que les arcs et les voûtes en berceau. Les premiers exemples de stéréotomie « savante » se trouvent sans doute dans la Syrie chrétienne du IVe siècle où l'on trouve des coupoles appareillées sur trompes ou en pendentifs. La stéréotomie romane offre de remarquables exemples d'architecture clavée, dont le plus célèbre est l'escalier à vis de l'abbaye de Saint-Gilles du Gard.
Page 49 sur 51